 Edwy Plenel, le directeur de Médiapart, nous reçoit au siège de son journal, le lendemain de l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn. Médiapart ne parle que de cela, la France ne parle que de cela. Cependant, quarante minutes durant, Édwy Plenel ne parlera que de Nicolas Sarkozy et de la droite extrême qu'il incarne, du danger que ce "gagnant du Loto" représente pour la démocratie française voire du danger que sa réélection pourrait être pour tous les Français.
Edwy Plenel, le directeur de Médiapart, nous reçoit au siège de son journal, le lendemain de l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn. Médiapart ne parle que de cela, la France ne parle que de cela. Cependant, quarante minutes durant, Édwy Plenel ne parlera que de Nicolas Sarkozy et de la droite extrême qu'il incarne, du danger que ce "gagnant du Loto" représente pour la démocratie française voire du danger que sa réélection pourrait être pour tous les Français.
Le Président de trop (Don Quichotte Éditions) est un recueil de textes publié par Edwy Plenel entre septembre 2006 ou son exil Bruxellois et 2011 avec Médiapart, son journal en ligne. L'ancien patron des rédactions du journal Le Monde n'y va pas par quatre chemins : les politiques, de gauche comme de droite, jouent depuis trop longtemps avec le feu de l'extrême droite. Marine Le Pen pourrait mettre tout le monde d'accord.

LALETTREDULIBRAIRE.COM : Depuis janvier 2007, vous comparez souvent Nicolas Sarkozy à Napoléon III. N’a-t-il pas glissé depuis vers une sorte de boulangisme, le romantisme en moins ?
EDWY PLENEL : Pour l’instant, Nicolas Sarkozy n’a pas été se suicider sur la tombe d’une maîtresse en Belgique comme le Général Boulanger ! Mais votre allusion est pertinente. Le boulangisme a été un grand moment de confusion, de crise de la République, que la République a su surmonter, y compris avec des passages de gens de gauche rejoignant des gens plutôt de droite, et plutôt de droite extrême sur fond d’extrémisation du débat public autour de l’antisémitisme. C’est le moment de l’affaire Dreyfus. Heureusement, la République a surmonté cette épreuve. Elle l’a surmontée, mais au bout du compte, l’Europe ne l’aura pas surmontée puisque ce fut un peu le théâtre idéologique de tout ce qui allait violenter l’Europe. Souvent, beaucoup d’intellectuels de cette époque se disaient que la catastrophe pourrait venir de France. Elle est venue d’Allemagne, mais dans cet affrontement avec la France.
Le propos du livre est, à travers la présidence de Nicolas Sarkozy, une interpellation de nous-même, de notre culture politique, de notre culture démocratique, de la fragilité de notre culture politique et de la faiblesse de notre culture démocratique. La France se croit très encrée, très solide sur ces valeurs. J’ai plutôt le sentiment que cette présidence, dans la façon dont elle a violenté le pacte républicain, dont elle a paralysé son opposition et dont elle a exacerbé les corruptions du présidentialisme français, nous montre que nous sommes un pays qui file un drôle de coton, sur fond de doute de l’Europe, de crise de nos sociétés.
C’est un livre d’alarme, c'est un livre d’inquiétude qui dépasse Nicolas Sarkozy et qui est finalement une adresse pour 2012 à tous ceux qui pourraient représenter ou prétendre représenter une alternative.
La Lettre : Vous parlez souvent de "droite extrême" à propos de Nicolas Sarkozy, de son discours, ou du discours de ses ministres. Pourquoi ne pas parler franchement d’extrême droite ?
Ed. P. : C’est très volontaire. Parce que l’extrême droite est une famille politique, idéologique, qui a d’ailleurs ses lettres de noblesses intellectuelles. Charles Maurras, en tant qu’intellectuel de l’Action Française, est un talent objectif. Le fond idéologique de cette extrême droite, c’est le refus de la promesse républicaine des origines, celle de la Déclaration des Droits de l’Homme qui dit que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Au fond, la promesse démocratique c’est le droit d’avoir des droits.Le fond idéologique de l’extrême droite, c’est l’idée qu’il n’y a pas d’égalité, qu’il y a des hiérarchies naturelles et que, donc, il y a des différences en termes de droits, des différences naturelles selon l'origine, selon la naissance, selon les peuples, les races, etc. Et tout en découle...
Fondamentalement, après deux guerres mondiales, quelques génocides, ce qui fonde depuis 1946 le pacte républicain en France, c’est le refus de cela. C’est de dire que la France est une République démocratique et sociale. C’est de se revendiquer de la Déclaration des Droits de l’Homme et de préciser, dans le préambule de notre Constitution -c’était le cas pour la IVe République, et cela a été gardé dans la Ve -, que la République Française ne fait pas de différence entre citoyens selon l’origine, la race et la religion. Et même qu’elle respecte toutes les croyances. Ça, c’est notre le socle.
Dans notre histoire française, l’extrême droite n’a jamais été au pouvoir. Nous parlions du boulangisme précédemment : il a extrémisé le paysage politique, il n’a pas vraiment été au pouvoir.
Sous Pétain, sous Vichy, c’est un personnel de droite extrémisée de la IIIe République qui se retrouve à Vichy, l’extrême droite militante étant plutôt à Paris.
La Lettre : Hors, c’est la gauche qui a donné les pleins pouvoirs à Pétain....
Éd. P. : Ce sont les élites politiques, intellectuelles, économiques majoritaires du moment qui signent cet effondrement moral de la France.
Si l’on prend la période que nous payons toujours, d‘une décolonisation violente, tardive, devenant presque une guerre civile, c’est la gauche qui est au pouvoir et quand Jean-Marie Le Pen va accompagner cet engagement dans la guerre d’Algérie, il le fait sous un gouvernement socialiste.
Où veux-je en venir ? L’extrême droite dans notre pays n’a jamais représenté en elle-même une menace. Simplement, sa progression correspond à un moment où la droite républicaine oublie ses fondamentaux républicains et où la gauche oublie ses fondamentaux sociaux. Donc, si l’on prend ce qui nous arrive depuis trente ans - mon premier livre s’appelait « L’effet Le Pen » en 1984 (1) - le FN faisait déjà à cette époque deux millions  de voix aux Européennes, plus qu’il n'en a fait aux dernières cantonales. Donc cette hypothèque pèse sur notre pays bien avant la droitisation profonde de l’Europe -nous sommes un peu en avance de ce point de vue, hélas- pour moi, l’évènement que nous avons sous les yeux aujourd’hui c'est que, de la présence de cette hypothèque d’extrême droite, est née une droite extrême. Et c’est là que ça devient grave. Qu’il se passe quelque chose. C’est là qu’au cœur des pratiques institutionnelles, des majorités politiques se réclamant de la République se fait la dérive. Vous avez parlé de Vichy : c’est un personnel politique républicain qui, du jour au lendemain, accepte l’impensable.
de voix aux Européennes, plus qu’il n'en a fait aux dernières cantonales. Donc cette hypothèque pèse sur notre pays bien avant la droitisation profonde de l’Europe -nous sommes un peu en avance de ce point de vue, hélas- pour moi, l’évènement que nous avons sous les yeux aujourd’hui c'est que, de la présence de cette hypothèque d’extrême droite, est née une droite extrême. Et c’est là que ça devient grave. Qu’il se passe quelque chose. C’est là qu’au cœur des pratiques institutionnelles, des majorités politiques se réclamant de la République se fait la dérive. Vous avez parlé de Vichy : c’est un personnel politique républicain qui, du jour au lendemain, accepte l’impensable.
C'est le thème de mon livre. Autant les surprises démocratiques surviennent sans qu’on les voit venir - je pense aux révolutions démocratiques arabes - autant les catastrophes surviennent par renoncements successifs. Les régressions profondes surviennent par abandons successifs.
Donc mon inquiétude depuis quatre ans, c’est non seulement tout ce qui s’est commis comme violation du pacte de 1946 -qui réunissait des gaullistes aux communistes sur les fondements d’une république démocratique et sociale- mais aussi l’impuissance des oppositions - et principalement du PS - à combattre cette régression et à présenter un agenda alternatif.
Mais je vais vous faire peur : dans un deuxième tour Nicolas Sarkozy-Marine Le Pen, êtes-vous sûr que Nicolas Sarkozy l’emporte ?
La Lettre : Dans cette "droite extrême", n’y-a-t-il pas le germe d’une alliance entre Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen entre les deux tours de l’élection présidentielle ?
Éd. P. : Je me refuse à prédire l’avenir. Les journalistes sont déjà assez surchargés de travail s’ils se contentent de bien décrypter le présent, qui lui-même est encombré de passé. L’avenir n’est pas écrit, l’avenir est aussi fait d’évènements, de surprises, d’inattendu. Qui aurait pu penser, même si maintenant on en comprend l’historique, l’évènement stupéfiant qui arrive au Parti socialiste et qui sera ravageur avec ce fait divers personnel qui implique Dominique Strauss-Kahn. Donc, l’histoire n’est pas écrite. Ce qui est écrit, c’est cette menace d’une régression. Mais je vais vous faire peur : dans un deuxième tour Nicolas Sarkozy-Marine Le Pen, êtes-vous sûr que Nicolas Sarkozy l’emporte ?
La Lettre : En 2007, dix-neuf millions de Français ont voté pour Nicolas Sarkozy en sachant que son modèle politique est Georges W. Bush. Les Français ne souhaitaient-ils pas tourner la page d’une certaine politique ?
Éd. P. : Je pense qu’en 2007 les Français n’ont pas vu cette réalité de Nicolas Sarkozy. Parce que toute l‘habileté de sa campagne a été de le masquer et non seulement de le masquer dans sa communication, dans ses discours mais aussi d’avoir déjà une stratégie de contrôle des médias, de contrôle de l’agenda médiatique, de sorte qu’on ne rappelle pas ce qui le dérangeait, ce qui montrait son vrai visage. Cette violence de Nicolas Sarkozy vis-à-vis des médias a été très profondément en sa faveur. Je dirais que mon itinéraire personnel en témoigne, dans la mesure où j’ai assisté aux "normalisations préalables", notamment celles du quotidien Le Monde à ce moment-là.
Nicolas Sarkozy a mené une campagne qui n’était pas sur les thématiques de Georges W. Bush, mais qui était sur les thématiques de cette triangulation où il va sur le terrain de la gauche, où finalement il fixe un agenda qui paralyse son adversaire parce que c’est lui fixe l’ordre du jour. Il cite Jaurès, il cite Léon Blum, il parle de la République irréprochable, il parle de la valeur du travail, etc. Il ne dit pas qu’il va détruire la sécurité sociale, il dit l’inverse. Je rappelle que pendant la campagne électorale, il dit qu’il ne touchera pas à la retraite à soixante ans, il s’y engage fermement. Il dit en bonne part tout le contraire de ce qu’il dit qu’il va faire. Il érige le mensonge politique, médiatique en véritable politique.
Nous en avons la symbolique tout de suite : il est élu sur tout cela. Il laisse entendre avant d’être élu, qu’il ira faire une retraite parce qu’il rentre dans la "gravité" de la fonction. On pensait avoir élu un Président, on découvre que l’on a élu un gagnant du loto qui va sur le yacht de Bolloré. Une fois élu, il déconstruit tout cela parce qu’il fait cette politique. Ce qui est un refrain de mon livre, c’est que nous avons bien vu quelle politique il a faite.
Et la majorité de l’opinion - les sondages en témoignent - l’a bien vu, y compris ses propres électeurs. Mais elle a eu lieu. Rien ne l’a vraiment entravée. Et ça c’est un événement grave. Il y avait la possibilité de construire un rapport de force social, politique, idéologique, intellectuel.Mais leurs divisions, par précaution, les oppositions n’ont pas eu lieu, qu’elles soient du centre, qu’elles soient gaullistes, qu’elles soient de gauche -et je dis souvent que la présidence de Nicolas Sarkozy n’est forte que des faiblesses et des divisions de ses oppositions et à un an de la présidentielle, c’est plus vrai que jamais.
LaLettre : À propos des électeurs de 2007, ils ont voté pour un homme qui n’aime ni manger, ni boire et assez peu la littérature. Comment expliquez-vous qu’avec tous ces défauts, Nicolas Sarkozy ait néanmoins été élu ?
Éd. P. : (rires) Je ne le verrais pas comme ça. Je crois que Nicolas Sarkozy a suscité un authentique espoir en profondeur. Il y a une grande mobilisation de l’électorat, l’abstention a été en régression parce qu’il a lancé l’espoir de la volonté. Il a dit « peu importe comme je suis, je suis ce petit Français de sang-mêlé, je suis ce que je suis, mais on ne va pas subir la fatalité". C’est ça qu'il a fait passer et la vérité, c’est que tout le monde a envie d’entendre ça, encore aujourd’hui.
Nous vivons une crise économique historique, c’est la troisième crise de cette ampleur du capitalisme. Elle est loin d’être terminée. Nous vivons un décentrement du monde où l’Europe et donc la France n’aura plus le même poids. Il va falloir s’y habituer. Mais cela fait cinq siècles que, pourtant, nous sommes habitués à donner le la du monde. Nous vivons une crise démocratique profonde, on a le sentiment que la politique nous échappe, qu'on n’a pas de prise. Nous vivons une crise systémique de la construction européenne qui a déterminé toute notre après-guerre, où l’Europe ne parle pas aux peuples, nous vivons tout cela. Et dans ce moment-là, on a envie d’entendre un politique, démagogique ou sérieux, mais on a envie d’entendre un politique qui dit "oui, nous n’allons pas subir ça. Je vais vous montrer une voie de résistance, de refus". Et nous sommes devant ce moment-là : vous verrez les discours de 2012, y compris de l’extrême droite, seront ceux-là, seront ceux de ce volontarisme politique.
Donc, on en revient toujours aux mêmes questions : pourquoi l’opposition n’a pas réussi à montrer que ce volontarisme politique de Nicolas Sarkozy était une imposture, était fait pour une minorité, était un mensonge ? On est toujours devant ce problème. Les Français ont entendu ce discours-là, ils ne l’ont pas entendus ailleurs. Ils ont entendu ailleurs un discours beaucoup plus sombre. C’est moins vrai d'une certaine manière pour Ségolène Royal qui tentait d’épouser ce discours-là, mais elle était paralysée elle-même par les divisions de sa propre famille.
Mais vous voyez bien que nous avons aujourd’hui un vrai problème d’un monde politique qui a le poids de la complexité du monde et comment, face à cette complexité du monde, réinstaurer la volonté. Ma réponse est simple. Il n’y a qu’un levier pour cela, c’est la réappropriation collective du levier démocratique. Sinon, on va re-choisir un nouveau César, un nouveau Bonaparte, un nouveau Boulanger, un nouveau Sarkozy. C’est-à-dire qu’on va reprendre le même raccourci présidentiel où l’on va choisir quelqu’un qu’on mettra à la place de Sarkozy. Mais, dans ce cas-là, tout échouera à nouveau.
La seule façon, c’est ce que j’appelle une "insurrection démocratique", qui ne se décrète pas, c’est que nous nous réapproprions collectivement les moyens de discuter, de décider, de confronter tout cela. Mais être dans cette servitude, cette soumission au choix d’un seul, je pense que c’est le meilleur chemin pour finalement perdre le pouvoir que nous déléguons. Oui, perdre le pouvoir que nous déléguons et être soumis à la volonté prédatrice d’une minorité.
La Lettre : On vous sent aussi en colère contre la gauche.
Éd. P. : Nous faisons cet entretien au lendemain du week-end qui est ce « tremblement de terre » comme a dit Martine Aubry en employant la même formule qu’en 2002, alors qu’il ne s’agit pas de résultats électoraux mais de cette histoire stupéfiante qui arrive au président du FMI qui était LE candidat de la direction du Parti socialiste aux primaires socialistes.
Et, en effet, je me dit que les socialistes, dans ce fait divers qui est comme un battement d’ailes de papillon qui créé à l’autre bout de la Terre un cyclone, n‘ont pas lu, notamment ce que j’écrivais il y a deux ans, cette Lettre à ces socialistes qui nous désespèrent.
Il y a un proverbe qui dit « comme on fait son lit on se couche » : il dit justement ce que je vous dis sur les catastrophes, à savoir que tout ce qu’on l’a fait un jour se paie. Je pense que les socialistes, et j’espère que tout à coup ils en auront le sursaut - mais je n’en suis pas convaincu - vont payer ce qui s’est passé depuis quatre ans. Qu’ils n’aient pas pris la mesure de ce que signifiait leur défaite en 2007, avec notamment le débauchage de nombre d’entre eux. Ils ont tous renvoyé à des parcours individuels ces gens de gauche qui ont été travailler avec Nicolas Sarkozy sans voir que tous ces gens étaient issus de toute la diversité de leur histoire socialiste et qu'ils devraient s’interroger sur cela. C’était la première fois que, hors d’une crise nationale, on voyait des gens changer de famille politique comme de trottoir, de la gauche à la droite. On n'a pas vu l’inverse.
Deuxièmement, pendant ces quatre ans, ils se sont enfermés sur eux-mêmes, ils n’ont pas parlé aux autres forces de gauche et ils ont très peu parlé au pays.
Troisièmement, par rapport à toutes les politiques concrètes menées par Nicolas Sarkozy, ils ont délégué au monde syndical, délégué au monde associatif, ils n’ont pas su susciter un rapport de force, une dynamique dans le pays notamment de manière unitaire, rassembleuse.
Quatrièmement, ils n’ont saisi aucun évènement pour vraiment faire de la pédagogie. Que ce soit la pédagogie au moment du discours de Grenoble, qui permettait de rappeler le pacte républicain, quand tout à coup on désignait les Français d’origine étrangère. Que ce soit la pédagogie autour des révolutions arabes, qui sont la plus belle nouvelle qui soit et dont il fallait s’emparer pour combattre ceux qui allaient s’en saisir pour réactiver la peur qu’elles démentaient.
J’ai une immense déception parce que je ne suis pas un irresponsable, je suis un citoyen qui pense qu’il faut des alternatives et des solutions, et malgré mon indépendance de journaliste et mon esprit critique que j’ai toujours exercé sur la gauche au pouvoir, je souhaite qu’il y ait une alternative mais sincèrement je ne crois pas qu’une alternative ce soit un arrangement d’appareil, un parti qui n’arrive pas à se mettre d’accord et qui demande au peuple de venir choisir son leader à sa place et que ce soit surtout un parti qui est dans l’inconscience, qui a parié sur le leader le plus fragile, puisqu'au fond, le fait divers Strauss-Kahn révèle que le parti socialiste, dans sa direction majoritaire, avait misé sur ce qui pouvait au bout du compte lui exploser entre les mains.
C’est bien cela qui se passe sous nos yeux. Il y a un évènement qui appelle de leur part un immense sursaut. Je ne suis pas certain qu’ils en soient capables parce qu'il y a derrière quelque chose qui vient de bien plus loin, qui vient pour moi – je l’ai écrit dans La part d’ombre (2) en 1991, autour de la présidence de  François Mitterrand, qui vient de la façon dont les socialistes n’ont pas assez fait retour sur leur propre rapport au pouvoir, sur leur institutionnalisation, sur leur perte d’enracinement populaire au niveau militant.
François Mitterrand, qui vient de la façon dont les socialistes n’ont pas assez fait retour sur leur propre rapport au pouvoir, sur leur institutionnalisation, sur leur perte d’enracinement populaire au niveau militant.
On l’a vu avec l’anniversaire des trente ans du 10 mai 1981. Rendez-vous compte ! Le concert à la Bastille a été organisé par deux hommes d’affaires – un banquier et un milliardaire du luxe – qui eux-mêmes sont maintenant dans la presse. Ce sont eux qui ont financé, mais ne se sont pas contenté de financer : ils ont été la puissance invitante, ceux auprès desquels les dirigeants socialistes sont venus rendre visite et, quelque part, rendre hommage.
On aurait aimé d’un parti dit "responsable" une inversion des rôles. C’était à eux d’organiser ce concert, c’était à eux d’y faire de la politique (on n'a pas entendu de politique pendant ce concert), c’était à eux de dire à ces millionnaires – on a le droit d’avoir des convictions politiques à l’inverse de sa fortune, et c’est très respectable, au contraire, c’est très bien d’avoir des convictions qui ne vont pas dans le sens des intérêts matériels. On peut être riche et de gauche, on peut être riche et social et c’est très bien. Mais dans ce cas, on inverse le rapport « vous financez mais c’est nous qui faisons de la politique ».
Je souligne cela, car on voit bien dans cette séquence que l’on a un parti socialiste qui n’a pas su faire retour sur son histoire. Il a failli le faire avec Lionel Jospin. Il a été pris, et on revient au thème de mon livre, dans les rais du présidentialisme.
C’est la clé de l’échec de Lionel Jospin, c’est l’inversion du calendrier, alors que le calendrier permettait de mettre la question parlementaire au cœur, en ayant des législatives avant la présidentielle. Le parti socialiste lui-même est pris au piège de ce que je raconte, qui n’est pas une fatalité mais qui est que ces institutions sont corruptrices, que ce présidentialisme dévitalise la politique et qu’il est totalement nuisible à des partis qui prétendent défendre - c’est la raison d’être de la gauche - les intérêts des classes sociales majoritaires, mais dont les intérêts ne sont pas dominants, c’est-à-dire les ouvriers, les employés, etc. Donc, nous sommes au cœur de ces vices du présidentialisme que je décris.
Vous avez dit que je suis en colère. Je suis plus navré qu’en colère parce que je suis vraiment inquiet. J’ai écrit « L’effet Le Pen » en 1984 (1), il s’agissait du père. Nous sommes avec Marine Le Pen, j’ai sonné l’alarme sur tout ce qui se dégradait par rapport à cette République inachevée – c’était le titre de mon deuxième livre en 1985 (3) – j’ai sonné l’alarme sous François Mitterrand, sous Jacques Chirac, sous Nicolas Sarkozy. J’attends ce sursaut, je l’espère, mais je ne le vois pas incarné dans les forces ou les leaders politiques du moment. C’est ce qui me soucie.
mon deuxième livre en 1985 (3) – j’ai sonné l’alarme sous François Mitterrand, sous Jacques Chirac, sous Nicolas Sarkozy. J’attends ce sursaut, je l’espère, mais je ne le vois pas incarné dans les forces ou les leaders politiques du moment. C’est ce qui me soucie.
La Lettre : Depuis 1985, et le changement de mode de scrutin des législatives par le Président François Mitterrand et son Premier ministre Laurent Fabius, le pouvoir politique joue dangereusement avec l’extrême droite. Est-ce que l‘habileté politique de Marine Le Pen pourrait mener cette extrême droite au pouvoir ?
Éd. P.: Le problème, comme je l’ai dit, n’est pas l’extrême droite. L’extrême droite n'existe dans nos pays, en Europe, que par les renoncements de la droite et de la gauche.
Ce n’est pas Marine Le Pen qui a tenu le discours de Grenoble sur les Français d’origine étrangère, qui a tenu le discours de Dakar sur les Africains qui ne sont pas rentrés dans l’Histoire, qui stigmatise nos compatriotes musulmans ou qui dit que l’on n'est plus chez nous en France. Ce n’est pas l’extrême droite qui a dit très tôt - mais hélas la gauche ! - que Jean-Marie Le Pen et le Front National posaient de bonnes questions mais y apportaient de mauvaises réponses. Ce n’est pas l’extrême droite qui a imposé toute seule son agenda. C’est la faiblesse, c’est ce manque de force, de hauteur de ces forces de la droite et de la gauche française.
De quoi manquons-nous ? Il y a des programmes politiques et il y a plein d’idées. Les socialistes ont travaillé et il y a aussi de bonnes idées dans d’autres forces politiques, les écologistes, le front de gauche, le parti de gauche, y compris chez certains centristes ou gaullistes, il y a plein de bonnes idées.
Ce n’est pas de programmes politiques que nous manquons. Nous manquons d’un nouvel imaginaire politique qui nous unifie, qui nous rassemble, qui nous transporte. Pour avoir ce nouvel imaginaire politique, il faut que nous osions un imaginaire de ce qu’est notre pays. Il nous faut assumer notre pays.
Assumer notre pays, c’est assumer la longue durée de son histoire, non pas pour la juger, non pas pour la condamner mais pour l’assumer telle qu’elle nous a fait. En l’occurrence, la France a une spécificité en Europe, qui est sa chance dans le monde globalisé d’aujourd’hui. La France est, au niveau de son peuple, une Amérique de l’Europe. Elle est faite, profondément, des courants migratoires internes - le Breton que je suis peut en témoigner et longuement et expliquer cette histoire par rapport à comment ce pays s’est unifié et, profondément, c’est l’immigration belge, l’immigration polonaise, l’immigration d’Europe centrale à l’immigration espagnole, italienne, portugaise et, évidemment, la très longue durée de notre histoire coloniale.
Aujourd’hui, la France a une chance inouïe, c’est la fille aînée de l’Église, c’est le pays de l’Édit de Nantes donc du protestantisme, c’est le pays de la première communauté juive d’Europe, c’est le premier pays musulman – en proportion- d’Europe, c’est le pays de la créolisation. Je parle beaucoup des outremers dans ce livre. C’est aussi le pays de la Laïcité ce qui, je le rappelle, en 1905, n’est pas une déclaration de guerre aux croyances mais, au contraire, une façon d’inventer une laïcisation dans l’espace public, de la présence dans l’espace public de ceux qui, par ailleurs, ont des croyances.
Sans la loi de 1905, il n’y aurait pas eu cet évènement formidable pour le catholicisme qu’est le catholicisme social militant, les prêtres ouvriers, les jeunesses ouvrières chrétiennes, les jeunesses étudiantes chrétiennes. Tout cela a permis à des gens de se rassembler autour de ce qu’ils ont en commun, par-delà leurs croyances, leurs sensibilités, leurs communautés, etc.
Je crois profondément à cette vitalité de notre histoire, à cette vitalité de l’horizon républicain, de cette espérance démocratique. Je pense que pour arriver aujourd'hui à nous sortir de l’ornière, il faut prendre cette ligne de crête. Nous l’avons senti dans un moment – vous parliez de Georges Bush Junior - quand, sous la présidence de Jacques Chirac et avec Dominique de Villepin, toute la France s’est reconnue dans cette position. Et cette façon de se projeter sur le monde, de parler de la fragilité du monde, de parler d’un petit pays qui néanmoins avait de grandes ambitions pour le monde. Je crois profondément que la France n’est elle-même – et c’est un discours de patriote quelque part – que dans une relation avec le monde. Et que la France est en crise, qu'elle est en régression quand elle décroche du monde.
La Lettre : Lorsque Jacques Chirac et Dominique de Villepin parlent au monde pour expliquer leur refus de la guerre en Irak, la France parle le verbe haut et intelligemment. Est-ce que Nicolas Sarkozy, pour des raisons électoralistes, flatte les bas instincts de chaque communauté ?
Éd. P : On est dans un moment ou le langage est très bas. Je rappelle cette phrase d'Albert Camus dans un éditorial de Combat, le 31 août 1944, disant « notre désir, d’autant plus fort qu’il était muet, était d'élever ce pays en élevant ce langage ». Il parle des journalistes qui écrivaient des feuilles clandestines. C’est l'inverse du « casse-toi pov’ con » comme pédagogie politique.
La présidence de Nicolas Sarkozy, et c’est dans ce sens que c’est une droite extrême, a profondément fait une pédagogie de la virulence, de la violence, de l’hystérie de la politique, qui n’est pas une façon de rassembler le pays, qui est une façon de le mettre en guerre avec lui-même. Cela rejoint ce que je vous disais, s’il n’y a que ma communauté contre ta communauté, mon identité contre ton identité, mon origine contre ton origine, c’est la guerre de tous contre tous. La démocratie, la République, c’est se rassembler au-delà de nos identités, autour de ce que nous avons en commun. Des questions de salaires, des questions sociales, d’emploi, de pouvoir d’achat, de liberté d’expression. C’est retrouver ce que nous avons en commun. Nous sommes au cœur de ce moment-là.
Nous sommes devant un moment de bifurcation. Je pense depuis longtemps, tous mes livres en témoignent, tout mon parcours professionnel en témoigne, que la France est le pays malade de l’Europe. C’est le pays qui n’a pas regardé en face son effondrement national sous la Seconde Guerre mondiale. C’est la ruse du Général de Gaulle de nous avoir mis sur le banc des vainqueurs et je rappelle que cette ruse n’aurait jamais été possible sans tous ces Français d’ailleurs, qui aujourd’hui ne seraient pas Français. Je rappelle que, en 1943, dans les Forces Françaises Libres (FFL) -qui ont permis au Général de Gaulle de mettre la France à la table des vainqueurs, alors qu’elle aurait dû être chez les vaincus puisque les élites avaient choisi la collaboration-, 60% des FFL sont faites de troupes coloniales et 18% de légionnaires. Vous avez près de 80% de cette France d’origine étrangère d’aujourd’hui. C’est celle-là qui nous a sauvés. Il y a eu le refus de regarder ça en face.
Il y a eu un deuxième refus qui imbrique, comme le précédent, la gauche aussi et profondément – et c’est toute l’histoire de François Mitterrand de l’une à l’autre - de la francisque à la guerre d’Algérie, qui est cette histoire coloniale. Nous sommes le pays qui, parmi les grandes puissances coloniales, a connu la décolonisation la plus violente, la plus tragique et qui n’a pas débouché sur un sursaut démocratique mais sur un putsch, sur un coup d’état d’extrémisation que, de la même manière, de Gaulle a retourné, en nous dotant de ces institutions.
Pourquoi je fais ces rappels-là ? Il y a deux pays en Europe qui ont deux caractéristiques, à savoir qu'ils n’ont pas de forces d’extrême droite, ou vraiment anecdotique, et qui ont des gauches plutôt rassemblées, plutôt unitaires, plutôt fortes et en cohésion, en tout cas moins éclatées et moins divisées. Ces deux pays, qui n’ont pas la même puissance, sont l’Allemagne et le Portugal. J’y vois un rapport avec l’Histoire.
L’Allemagne est LE pays d’Europe qui ne peut pas dire « c’est la faute aux autres ». Tous les autres pays d’Europe, peu ou prou, se sont arrangés, peu ou prou, avec leur histoire en disant « c’est la faute de l’Allemagne ». L’Allemagne a été obligée, ça fait même partie de sa culture institutionnelle, de regarder ses crimes en face. Non pas pour se condamner pour l’éternité, mais « ça fait partie de notre histoire », la barbarie a surgi dans la civilisation.
Quant au Portugal, c’est la dernière décolonisation avec l’Angola et le Mozambique, qui a produit non pas un coup d’état régressif mais une révolution sociale et démocratique, avec même une armée qui était dans cette dynamique à l’époque la fameuse Révolution des œillets.
Dans les deux cas, il y a eu une histoire différente. D’un côté on regarde en face et de l'autre on se force à regarder en face. Nous arrivons à un moment où nous payons cela. Je pense que nous le payons eton en revient à la gauche parce qu'il y avait un moment pour sanctionner ça, pour dépasser ça, pour s’élever, c’était 1981. Quand, l'après mais 68 et le mouvement dynamique, social, démocratique a produit l’alternance avec François Mitterrand. Et là, on en revient au présidentialisme. Le premier procureur de ce système est devenu son meilleur avocat, il a été vaincu par le système, il s’est laissé vaincre par le système.
La Lettre : Vous reprenez les propos de Jacques Baynac dans la revue Le Débat de Janvier 2010. Il écrivait « L’homme idéal dans cette société (celle de Nicolas Sarkozy) est un homme sevré de réel et nourri de fiction ». Est-on, aujourd’hui, au comble de ce constat médiatique et people imposé par le Président Sarkozy ?
Éd. P. : Bien sûr. Nous sommes dans ce moment où il y a le risque d’une perte du réel, d’une perte du sens, d’une perte de l’intelligibilité. Vous le voyez, y compris de façon médiatique, il domine l’opinion. Dans le livre, comme dans mon travail depuis trente-cinq ans, mes analyses se rapportent à des faits, à une bataille en tant que journaliste sur ces vérités de fait, qui ne sont pas des fictions et qui doivent être regardées en face, entre d'un côté, un discours politique et, de l'autre, les engagements concrets qui sont pris et la réalité qui est faite. Entre les corruptions qui dévoilent le vrai visage du monde économique et du monde politique, etc..
Nous sommes dans ce moment où il y a ce risque : l’opinion, c’est-à-dire le relativisme général, l’emporte sur la rationalité et c’est un vrai défi pour les journalistes que nous sommes parce que notre travail c’est de sauver du sens à partir de cette réalité.
La Lettre : Jean-Paul Delevoye, le médiateur de la République, écrit dans son rapport sur la société française que « politiquement cela peut mal tourner ». Y voit-il une espèce de transgression du mur qui séparait la droite républicaine de l’extrême droite ?
Éd. P.: Bien sûr. Le rapport de Jean-Paul Delevoye, qui est un gaulliste, m’a troublé énormément. Parce que cet homme, en tant que médiateur, est sorti un peu des préjugés de sa famille politique et a vu cela. Le problème, c’est qu’il faudrait que beaucoup de politiques sachent cela, le sentent. Mais que font-ils ?
Médiapart a fait cet "Appel" au moment du débat sur l’identité nationale, qui a été signé de Dominique de Villepin à Olivier Besancenot. Si vous prenez cette présidence Sarkozy, c’est le seul moment où une telle initiative a rassemblé des gaullistes à l’extrême gauche. Nous sommes les seuls à avoir fait ça. Il y a eu les révolutions arabes : nous sommes les seuls à avoir fait une réunion publique de fraternité franco-arabe. Je suis très content que Médiapart ait réussi cela et, en même temps, je suis très désespéré parce que je me dit que, bien sûr, c’est très bien que Médiapart ait fait ça, mais j’aurais aimé que des forces politiques s’en emparent.
On n'est pas obligé de gouverner ensemble pour s’opposer ensemble. On n’est pas obligé d'être d’accord sur tout pour au moins dire « non » à ce qui est inadmissible. Et ça, ils n’ont pas su le faire, tous ensemble depuis 2007 et je pense que c’est dramatique, parce qu'on ne fait pas de la politique comme quelque chose en l’air. Il faut donner du courage aux gens et la seule manière de donner du courage, c’est la force de l’exemple. Nous, nous le faisons en tant que journalistes par rapport à notre profession avec Médiapart. Mais je suis très soucieux de voir que les responsables des formations politiques majoritaires n’en sont pas capables. Par moment, je pense qu’un effondrement est tout à fait possible et par d’autres moments - c’est aussi l’appel du livre : je cite Edgar Morin qui cite lui-même ce vers d’Hölderlin « Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve ». Et on pourrait parler de l’environnement, des catastrophes écologiques, des catastrophes sociales, de tous ces moment-là. Parfois, cette conscience du péril peut permettre d’inventer le sursaut.
Je dis à ma façon que l’inquiétude est l’antichambre de l’espérance mais aujourd’hui, au moment où nous faisons cet entretien, l’inquiétude domine.
La Lettre : Dernière question traditionnelle à la lettredulibraire.com. Quel livre conseilleriez-vous à nos lecteurs?
Éd. P. : On a deux possibilités de réponse. Soit on prend un livre fétiche, soit le livre que l’on a lu hier. Et j’ai lu hier l’entretien de Laure Adler avec Maurice Nadeau (4). C’est au fond une sorte de mise en abîme puisque c’est Maurice Nadeau, qui vient de fêter ses cent ans, et qui est à la fois un immense lecteur, un immense défenseur du livre. Il est l’homme des Cahiers de la Quinzaine, des Lettres Nouvelles et 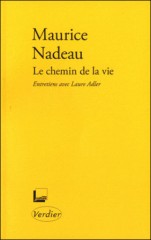 des éditions Maurice Nadeau. C’est un immense découvreur avec qui je partage, à d'autres générations, les mêmes engagements intellectuels puisqu’il fut pendant quinze ans trotskiste, ce que j’ai été dans ma jeunesse aussi et que je ne renie pas comme famille intellectuelle par rapport à ce qu’on appelait – on n’aimait pas dire trotskiste – "l’opposition de gauche" au stalinisme, la défense d’une certaine idée, au sein de la gauche, de certains principes.
des éditions Maurice Nadeau. C’est un immense découvreur avec qui je partage, à d'autres générations, les mêmes engagements intellectuels puisqu’il fut pendant quinze ans trotskiste, ce que j’ai été dans ma jeunesse aussi et que je ne renie pas comme famille intellectuelle par rapport à ce qu’on appelait – on n’aimait pas dire trotskiste – "l’opposition de gauche" au stalinisme, la défense d’une certaine idée, au sein de la gauche, de certains principes.
Spontanément, je vous parle de ce livre, qui est un livre d’entretiens dans lequel il y a des annexes dont un texte, que j’avais lu chez des amis mais que je n’avais retrouvé car c’était dans des Œuvres complètes de Balzac. C’est un texte de Maurice Nadeau sur le journalisme, à partir de Rubenpré, à partir de la figure du journaliste qui est très présente dans la Comédie humaine.
Je le recommande comme défense du livre, et encore plus comme défense de la lecture, indépendamment du support. De la lecture comme liberté, comme façon de rentrer tout seul dans un univers, où l'on est de soi à soi, mais avec mille autres mondes, mille autres personnes qui vous font réfléchir et qui vous mettent en avant.
Mais chacun pourrait dire ses clins d’oeil personnels. Mon univers personnel est un univers, une géographie littéraire où vous trouverez aussi bien Édouard Glissant – qui nous a quitté - Aimé Césaire, Saint-John Perse ou Victor Segalen. J’allais rajouter Gauguin avec ses Racontars du rapin. Au fond, c’est ce que Segalen appelait « l’esthétique du divers ». Mes goûts littéraires relèvent de cette « esthétique du divers » qui renvoie à tout ce que l’on s’est dit. C’est-à-dire assumer notre diversité, ne pas être dans des identités fixes, repliées, sectaires, fermées, closes et qui sont toujours mortifères et qui annoncent toujours des catastrophes.
(1)L'Effet Le Pen
Edwy Plenel & Alain Rollat
La Découverte
11 septembre 1984
(2) La part d'ombre
Edwy Plenel
Stock, 1991.
(3) La République inachevée
Edwy Plenel
Stock, 1985.
(4) Le chemin de la vie
Maurice Nadeau, Laure Adler
Verdier, avril 2011.
Entretien réalisé le 16 mai 2011.
Remerciements : Édwy Plénel, Médiapart, Agence Gilles Paris et Arnaud Bongrain.
Mis en ligne le 13 juin 2011.
